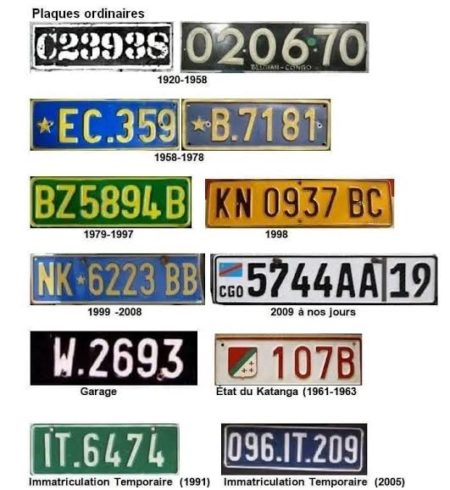Réunis à Doha le 15 novembre, les autorités congolaises et les rebelles se sont entendus sur une série de principes directeurs. Les négociations sur le fond doivent se poursuivre pour parvenir à un accord global, alors que la méfiance demeure.
Faut-il voir le verre à moitié vide ou à moitié plein ? Après plusieurs sessions de discussions infructueuses, les autorités congolaises et les rebelles de l’AFC/M23 ont franchi une nouvelle étape dans le processus de paix que pilote le Qatar depuis le mois de mars. Le 15 novembre, les représentants des deux parties ont paraphé à Doha un « accord-cadre ». Il s’agit d’un document qui énumère plusieurs principes directeurs pour parvenir à une cessation permanente des hostilités, ainsi qu’une série de protocoles censés encadrer la mise en œuvre de ces engagements.
À ce stade, il ne s’agit donc pas encore d’un accord de paix global, comme initialement espéré par la médiation, mais d’une sorte de feuille de route. Plus détaillée que la déclaration de principes signée le 19 juillet dernier, elle devra encore faire l’objet de négociations pour achever le processus. Les futures discussions porteront sur le contenu précis et le calendrier des protocoles qui, en complément de cet accord-cadre, formeront le futur accord de paix global et définitif.
En clair, ce sont les dispositions qui permettront d’avoir des effets concrets sur le terrain qui vont désormais devoir être discutées, ce qui pourrait prendre du temps, compte tenu de la méfiance qui persiste entre les deux parties. Benjamin Mbonimpa, le chef de la délégation de l’AFC/M23 à Doha, s’est d’ailleurs empressé de préciser que cette signature n’est assortie d’« aucune clause contraignante ». « Il n’y aura aucune modification de la situation sur le terrain ni aucune activité quelconque jusqu’à ce que les protocoles soient débattus, négociés l’un après l’autre jusqu’à la conclusion d’un accord global de paix », a-t-il expliqué, avant d’ajouter que « le chemin est encore long ».
Pression américaine et qatari
Présent à la cérémonie, Massad Boulos, conseiller pour l’Afrique de Donald Trump, a pour sa part estimé que cet accord-cadre est un « point de départ ». « Ce n’est que le début, mais nous savons que le résultat final sera très fructueux », a-t-il assuré, saluant une occasion « historique ».
Ces dernières semaines, la tension est restée vive entre Kinshasa et l’AFC/M23. Tous deux sont sous pression des États-Unis et du Qatar, qui souhaitent faire aboutir les médiations d’ici à la fin de l’année. Après avoir espéré une rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Washington le 13 novembre, l’administration Trump table désormais sur un sommet au cours de la première semaine de décembre. Quant à l’émir du Qatar, il prépare, en marge de ce processus de médiation, une visite à Kinshasa. Selon plusieurs sources gouvernementales congolaises, cette dernière était pour l’instant prévue autour des 20 et 21 novembre.
Les autorités congolaises et l’AFC/M23 se sont mutuellement accusés de mettre en péril les processus de paix, tandis que les combats se sont poursuivis dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. Doha a donc du redoubler d’efforts pour maintenir le cap et tenter de trouver un consensus. Plusieurs versions de l’accord-cadre avaient circulé entre les deux parties, mais ces dernières ont multiplié les désaccords, notamment autour de la question de la restauration de l’autorité de l’État. Si, pour Kinshasa, cela passe logiquement par un rétablissement de l’autorité gouvernementale, l’AFC/M23 a, à plusieurs reprises, manifesté son refus de céder le contrôle des territoires conquis depuis novembre 2021.
Huit protocoles sur la table
Sur cette question sensible, le dernier draft sur lequel les parties échangeaient ces derniers jours prévoyait un rétablissement progressif et coordonné des institutions et des services de l’État, selon un calendrier et des étapes que fixeront les protocoles. Sur le plan sécuritaire, l’AFC/M23 et les autorités congolaises devaient encore plancher sur des « arrangements sécuritaires transitoires ». Les modalités de ces futurs « arrangements », notamment la composition de leur commandement ainsi que la durée de leur mandat, doivent être négociés par la suite.
Au total, huit protocoles sont sur la table. Ils portent sur différentes thématiques, comme l’accès humanitaire, avec une possible déclaration d’un état d’urgence humanitaire et une désignation de la région comme zone sinistrée. Ils concernent aussi la démobilisation et la réinsertion des combattants, la justice transitionnelle (avec la potentielle mise en place d’une commission vérité et réconciliation), le retour des déplacés ou encore le redressement économique. Les mécanismes de surveillance du cessez-le-feu et d’échanges de prisonniers, respectivement conclus les 14 septembre et 14 octobre, font partie des protocoles cités dans l’accord. Aucun de ces deux mécanismes n’a pour l’instant produit d’effet.
Avec Jeune Afrique